Construction ou rénovation d’école : de l’idée à la validation du programme
Publié le 23/05/2024 5 minutes de lecture
Des locaux scolaires devenus trop énergivores, vétustes ou, qui ne permettent plus, faute de place, d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions, des effectifs scolaires en baisse. Comme pour les autres projets, la collectivité n’échappe pas aux études de programmation lorsqu’il s’agit de construire, de réhabiliter ou d’agrandir une école. Cette fiche recense les questions à se poser pour bien penser son programme concernant ce type d’équipements.

Réhabilitation, extension ou construction d’une nouvelle école ? Quel que soit le scénario choisi, la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, guide la collectivité (intégrée au Code de la commande publique depuis). L’article 2 du texte originel fixe les obligations du maître d’ouvrage : « Il lui appartient, après s’être assuré de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération envisagée, d’en déterminer la localisation, d’en définir le programme, d’en arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle […] ». Ce même article précise les éléments du programme : « Le maître d’ouvrage définit dans le programme les objectifs de l’opération et les besoins qu’elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement, relatives à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage ». Et appliqué à une école cela signifie de définir :
- de travailler les prévisions d’effectifs scolaires ;
- de bien connaître son territoire (projets de développement urbain, présence ou non d’un réseau de chaleur à proximité, besoins des associations locales, etc.) ;
- de trouver l’emplacement le plus adapté ;
- d’anticiper l’évolution des usages des établissements scolaires (en cours et à venir) ;
- d’apprécier les capacités d’investissement de la collectivité, etc.
FOCUSD’après l’Institut national de recherche et de sécurité, « au-delà de 30 °C pour une activité sédentaire et 28 °C pour un travail nécessitant une activité physique, la chaleur peut constituer un risque » pour la santé.
Hiérarchiser ses choix grâce aux études de programmation
Pour lancer un projet d’école, plusieurs étapes pourront permettre de finaliser le programme :
- études d’opportunité pour photographier la situation actuelle et formaliser les attendus notamment en termes d’effectifs à accueillir ;
- études de préfaisabilité pour élaborer différents scénarios répondant aux besoins et aux contraintes techniques, environnementaux, financiers avec choix d’un ou de plusieurs scénarios à affiner. À ce stade, il pourrait par exemple être envisagé un regroupement d’écoles au sein d’un groupe scolaire ou au contraire envisager de créer un autre établissement ;
- études de faisabilité pour approfondir le ou les scénarios retenus en fonction des éléments contextuels locaux (contraintes financières, disponibilités foncières, accessibilité du site, études topographiques, etc.) avec choix d’un scénario ;
- études de préprogrammation pour définir les objectifs et les moyens du scénario retenu, les attentes précises des utilisateurs et usagers, les arbitrages à réaliser, la liste des études et diagnostics disponibles et celles à réaliser, les exigences sur le coût, sur les matériaux, sur le ou les modes de chauffage, la planification, la participation des usagers au projet, etc.
- programme technique détaillé, pièce contractuelle qui sert à passer le marché de maîtrise d’œuvre. Il explique la genèse du projet, ses objectifs, l’organisation de la maîtrise d’ouvrage, le calendrier prévisionnel de l’opération, l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux, la présentation du site envisagé, les contraintes d’urbanisme à respecter, les plans, les études réalisées, la description des activités et des usages, les principes de fonctionnement et de l’organisation spatiale, la définition des espaces (surface, équipements, confort, lien avec les autres zones, etc. ), les choix techniques concernant les matériaux, le chauffage, la production d’énergie, etc.
La collectivité peut réaliser ces études en interne (notamment les premières) ou recourir à un programmiste.
FOCUSLes bâtiments neufs et les bâtiments d’une surface supérieure à 250 m2 classés dans la catégorie des établissements recevant du public de première à quatrième catégorie doivent faire l’objet d’un diagnostic de performance énergétique. 70 % des écoles sont concernées.
Parties prenantes
Les utilisateurs d’un site scolaire du premier degré sont nombreux. Il peut s’agir d’acteurs qui évoluent sur le temps scolaire (le temps de l’Éducation nationale) : les élèves, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les personnels employés par l’Éducation nationale tels que les directeurs d’école, les enseignants, les accompagnants d’élèves en situation de handicap, les psychologues scolaires… Sont également concernés les parents d’élèves fédérés en association et le conseil d’école, partenaire essentiel. C’est une assemblée composée du directeur de l’école, d’enseignants, d’élus, de représentants élus des parents d’élèves, du délégué départemental de l’éducation chargé de visiter les écoles. Cette instance établit et vote le règlement intérieur de l’école. Elle participe à l’élaboration et adopte le projet d’école, elle donne son avis sur les questions concernant la vie de l’établissement scolaire.
D’autres acteurs interviennent sur les temps dits périscolaires ou extrascolaires c’est-à-dire en début de matinée avant les cours, le midi, le soir après les cours, voire les mercredis, les week-ends et pendant les vacances. Ce sont les enfants, les familles, les animateurs employés soit par la collectivité (commune ou intercommunalité) soit par une association, les agents de restauration et d’entretien, les gardiens, les associations culturelles ou sportives qui utilisent une salle de motricité, un préau ou une cour d’école.
En dehors des plages horaires d’accueil des services scolaires, péri et extrascolaires, la cour d’école peut aussi se transformer en un espace de loisirs de proximité pour les riverains, ou en bureau de vote lors d’élections.
Mobiliser les usagers dès les études d’opportunité permet de concevoir l’opération en partant des besoins et idées de chacun, en partageant ce que la collectivité peut/veut faire. Faire se rencontrer des enseignants, des familles, des animateurs, des associations d’éducation populaire, des habitants du quartier, des agents territoriaux de la direction des espaces verts, technique, de la gestion des déchets, de l’éducation… L’intervention d’un chargé de mission à l’égalité femmes-hommes peut aider à enrichir les points de vue pour penser l’opération.
FOCUSUn bon programme : c’est 50 % de la réussite d’une opération !Les chargés d’opération expérimentés savent que la phase de programme est la plus importante dans le rôle de maîtrise d’ouvrage. D’abord parce que cela va cadrer la majeure partie du coût global du bâtiment ; une étude du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) analysant les données de la base de données Apogée sur les lycées sur 50 ans a montré que le programme déterminait plus de deux tiers des coûts sur 50 ans (1). Mais cela permet aussi d’être plus clair avec les maîtres d’œuvre, de leur éviter de reprendre des études, d’éviter des incompréhensions, les pertes de temps et les avenants.Mais souvent les élus veulent souvent aller trop vite en bâclant cette étape, pensant gagner du temps (et économiser en « études coûteuses et inutiles »).C’est un mauvais choix de gestion : la même étude du CSTB a montré que sur 50 ans, toutes les études (maîtrise d’œuvre comprise) représentent de l’ordre de 2 % du coût total. Si on veut faire des économies, il vaut mieux investir dans les études mais optimiser le coût de travaux (27 %), le coût du gros entretien renouvellement (30 %) et de l’exploitation maintenance (28 %).
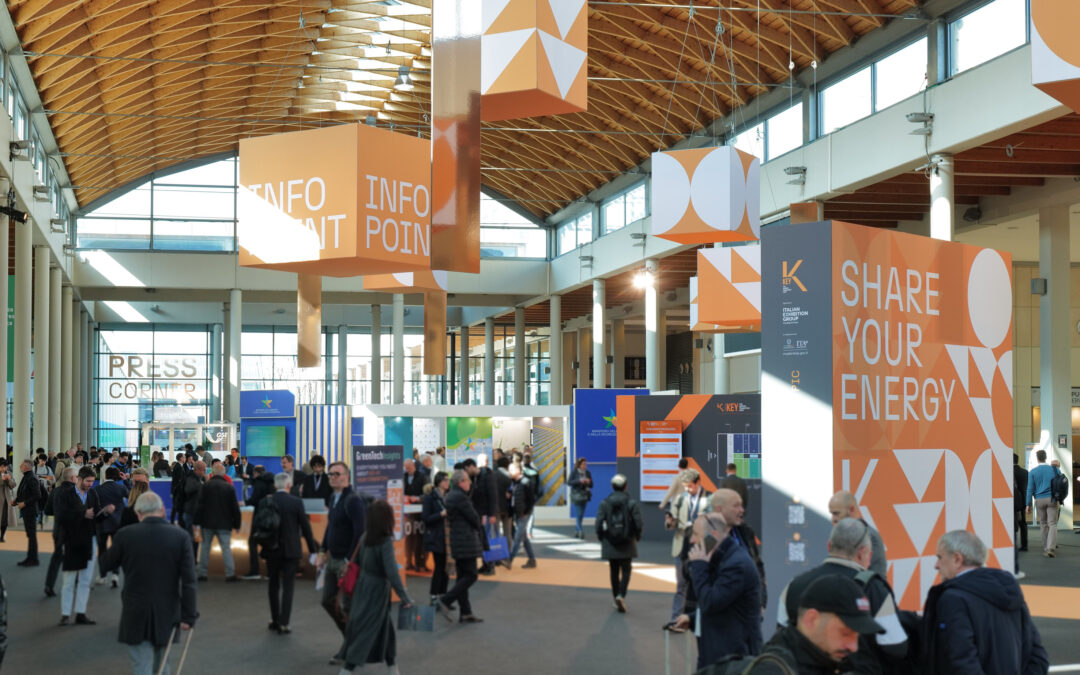
Key 2026, l’exposition sur la transition énergétique au programme en italie
Le poids des transports dans la pollution est connu et dans cette équation, on sait que la variable du dernier km est la plus complexe de l’équation.
Contenu offert par “KEY – The Energy Transition Expo”

Climat : combien les collectivités investissent dans la décarbonation ?
Ces dernières années, communes, intercommunalités, départements et régions ont fortement accru les dépenses en faveur de la décarbonation, indique une étude de l’Institut de l’Économie pour le Climat (I4CE). Des chiffres à prendre avec des pincettes.
par Valéry Laramée de Tannenberg – La Gazette des Communes

Jean-Marc Jancovici : « Les élus locaux doivent se préparer au choc du réchauffement climatique »
Jean-Marc Jancovici, président du Shift Project, appelle tous les élus municipaux à participer à la grande consultation lancée par son think tank. L’objectif est de recueillir leurs avis sur les enjeux climatiques et énergétiques de leur territoire, et de nourrir le débat des prochaines élections municipales.
par r Arnaud Garrigues – La Gazette des Communes

Ikea accélère sa décarbonation en mettant en place un transport longue distance 100 % électrique
Après la livraison fluviale à Paris, Ikea France teste un camion électrique pour relier ses dépôts entre l’Isère et la Provence. Une étape clé pour atteindre un objectif de transports zéro émission à terme.
par r Jean-Noël Caussil – LSA